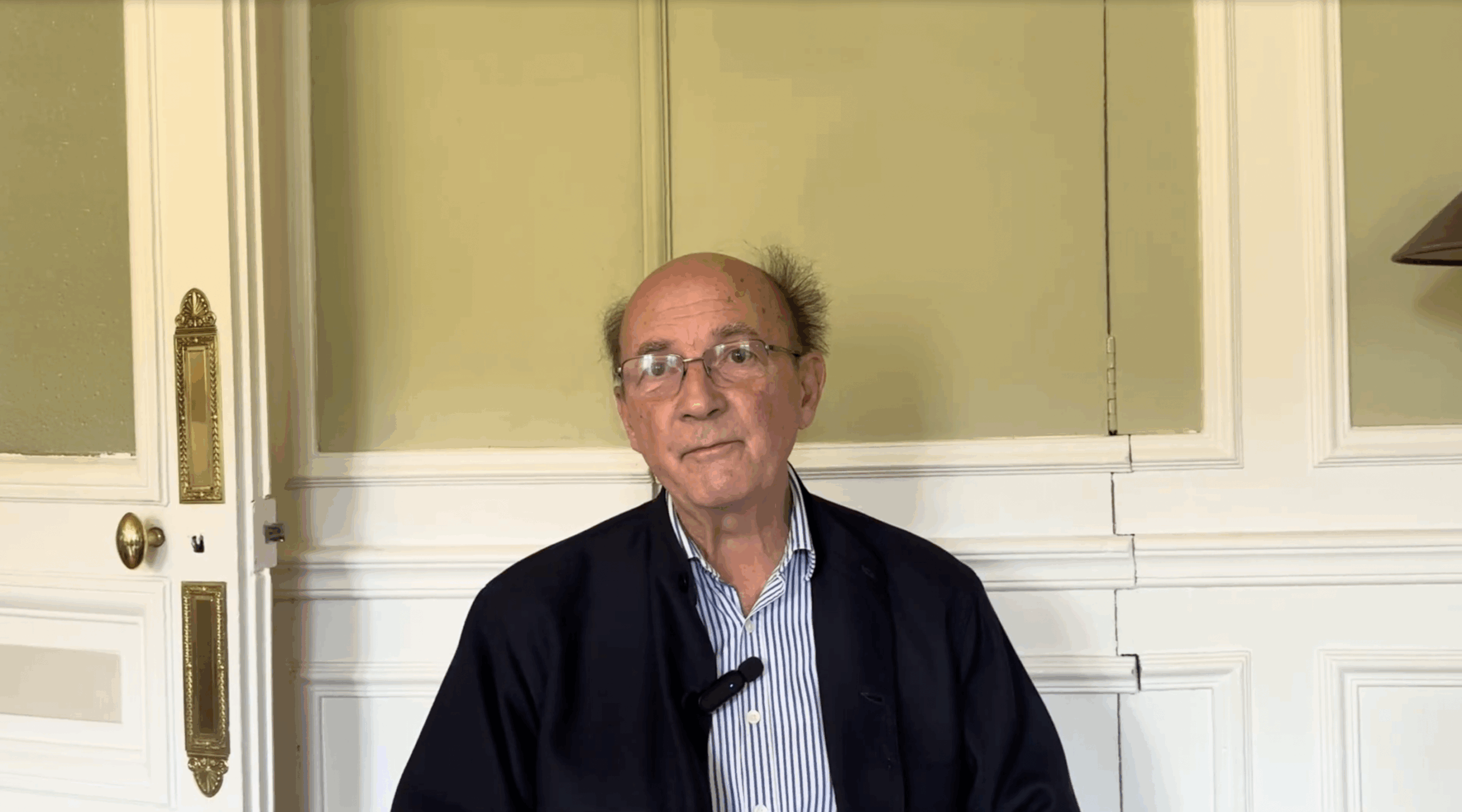
Le livre Ecrire la mer édité par Citadelles & Mazenod s’inscrit dans une série de publications thématiques qui ont exploré des sujets variés tels que l’amour, la nature et le rêve dans la peinture. L’ouvrage est riche de 500 pages, et comprend une centaine de textes sélectionnés et commentés minutieusement qui retracent l’évolution de la mer dans la littérature occidentale. L’auteur a choisi de mêler les grands classiques de la littérature antique avec des auteurs contemporains.
Une vision européenne de la mer
La sélection des auteurs, majoritairement française, a inclus également des écrivains d’autres pays européens tels que l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, et l’Angleterre, tout en mettant un accent particulier sur les littératures antiques.
L’évolution de la mer dans la littérature : de l’angoisse à la rêverie poétique
L’un des aspects les plus fascinants du livre est la description de l’évolution du rapport de l’homme à la mer, reflétée à travers les siècles. « La mer, pendant très longtemps était synonyme de danger », explique l’auteur. Dans l’Antiquité, la mer était vue comme un espace terrifiant, porteur de mystères et de menaces. Ulysse, dans L’Odyssée, navigue au milieu de créatures mythologiques comme les sirènes, et doit affronter des passes terrifiantes, comme celles de Charybde et Scylla. « La mer, c’était l’horreur, l’angoisse de l’engloutissement ».
Cette vision de la mer comme un espace dangereux a perduré jusqu’à la révolution de la marine à vapeur au 18e siècle, qui a permis d’accéder à la mer plus facilement, transformant progressivement l’océan en un lieu de loisirs et de voyage, comme le montre Robinson Crusoé de Defoë ou les écrits de Stevenson. L’auteur relève que « la mer est alors devenue un espace d’aventure, de voyage et de loisir ».
La mer : de l’infini à l’intériorisation poétique
Au 20 ème siècle, l’imaginaire littéraire a encore évolué. L’auteur évoque une transformation dans la manière dont les écrivains perçoivent alors l’océan. « À partir du moment où l’espace marin devient beaucoup plus facile d’accès, la mer réelle intéresse moins l’écrivain », explique-t-il. Il note que la mer est désormais « intériorisée » et devient une métaphore de l’infini ou de l’inconscient humain, comme le montre le poème « L’Homme et la Mer » de Baudelaire.
Ainsi, « la mer devient miroir de la conscience humaine ». Baudelaire fait de l’océan un reflet de la quête intérieure de l’homme, un espace d’introspection plus que de confrontation extérieure. Cette dimension intérieure se manifeste également dans l’œuvre de Michelet, La Mer, où l’écrivain lie la mer à l’image maternelle. « Il parle de la mer comme d’une mère qui façonne la terre », explique l’auteur, soulignant le lien symbolique entre mer et naissance.
Le regard porté sur la mer a donc évolué au fil des siècles, passant de la peur à l’admiration, de l’inaccessible à l’introspectif, tout en portant une richesse symbolique profonde.
La mer, entre expérience immédiate et questionnements écologiques
Dans la littérature contemporaine, l’auteur note une absence marquante de préoccupation écologique chez les écrivains, malgré les enjeux climatiques actuels. « Les écrivains contemporains n’ont pas conscience des enjeux climatiques liés à la mer », observe-t-il. Pourtant, les questions environnementales sont largement présentes chez les essayistes, mais « la littérature reste toujours de l’ordre de l’expérience immédiate ». L’auteur se demande si, en dehors des écrivains caribéens comme Chamoiseau, le souci de préservation de la nature est vraiment une préoccupation dans les œuvres littéraires.
Le contraste et donc marqué avec les écrivains du « Nature writing » américain, tels que Thoreau, qui ont eu une relation plus directe et conscientisée avec la nature. En revanche, dans la littérature française, la relation à la nature est souvent plus distanciée, comme l’explique l’auteur en évoquant les jardins français de l’époque classique, conçus pour offrir une vue maîtrisée sur le monde.
L’immersion dans la nature : la mer pour les peintres
Lorsqu’on évoque le lien entre les artistes et la mer, Daniel Bergez souligne une spécificité dans le travail des peintres : « Les peintres de la nature, et par exemple déjà les peintres italiens du XVIIIe siècle, ont un rapport immédiat, tactile, sensuel avec la nature. » Pour ces artistes, la mer n’est pas une abstraction intellectuelle, mais un élément vécu dans sa matérialité. L’émergence de l’impressionnisme au XIXe siècle marque un tournant important : « La peinture n’est plus un art d’intérieur, c’est un art d’extérieur, où la lumière et les sensations deviennent centrales. » Pour les impressionnistes, tels que Claude Monet, la mer devient un lieu de « fusion avec la nature », l’occasion d’une expérience presque écologiste, bien que non conceptualisée. Monet, en particulier, a peint en extérieur, capturant la lumière réelle de la mer, loin de la lumière artificielle de l’atelier.
Cependant, avec l’avènement de l’art abstrait et cubiste, ce lien immédiat avec la nature se dissipe. « L’art abstrait, c’est un oubli total de la nature. » Au XXe siècle, l’art moderne semble se détourner de l’aspect extérieur de la mer pour privilégier l’intériorité, une thématique que l’on retrouve également dans la littérature.
La mer, un monde d’oppositions : vie et mort
« La mer porte en elle un imaginaire où cohabitent à la fois la vie et la mort ». L’auteur souligne que dans des œuvres comme celles de Hugo, la mer devient à la fois un lieu de lutte et de régénération, de vie et de mort. Dans Les Travailleurs de la mer, Hugo illustre l’affrontement entre l’homme et la mer, avec une dimension mythologique complexe, symbolisant à la fois Eros et Thanatos. La mer, dans ces récits, est un terrain de conflit éternel, mais aussi un lieu d’accomplissement.
L’idée de la mer comme une dualité entre la vie et la mort trouve son ancrage dans la mythologie. L’auteur évoque la mythologie grecque, la figure de Poséidon, dieu de la mer et du mal, mais aussi celle de Vénus, née de l’écume de la mer, qui devient « une métaphore de la naissance et de la fécondité ». Cette dualité se retrouve aussi dans la vision tragique de la mer, comme dans l’œuvre de Melville Moby Dick, où l’océan est à la fois l’espace de la quête et celui de la destruction, une « énigme » qui reflète le combat éternel entre l’humanité et l’inconnu abyssal.
La mer, un miroir de l’humanité
L’auteur conclut que la mer est un espace complexe et paradoxal. Elle est à la fois le lieu de l’aventure, de l’inconnu, mais aussi un espace d’introspection, où l’homme explore ses propres limites. Portant en elle des symboles de vie et de mort, de naissance et de destruction, la mer continue d’inspirer tant les écrivains que les artistes, auxquels elle offre une source d’inspiration inépuisable.
Témoignages du même tableau