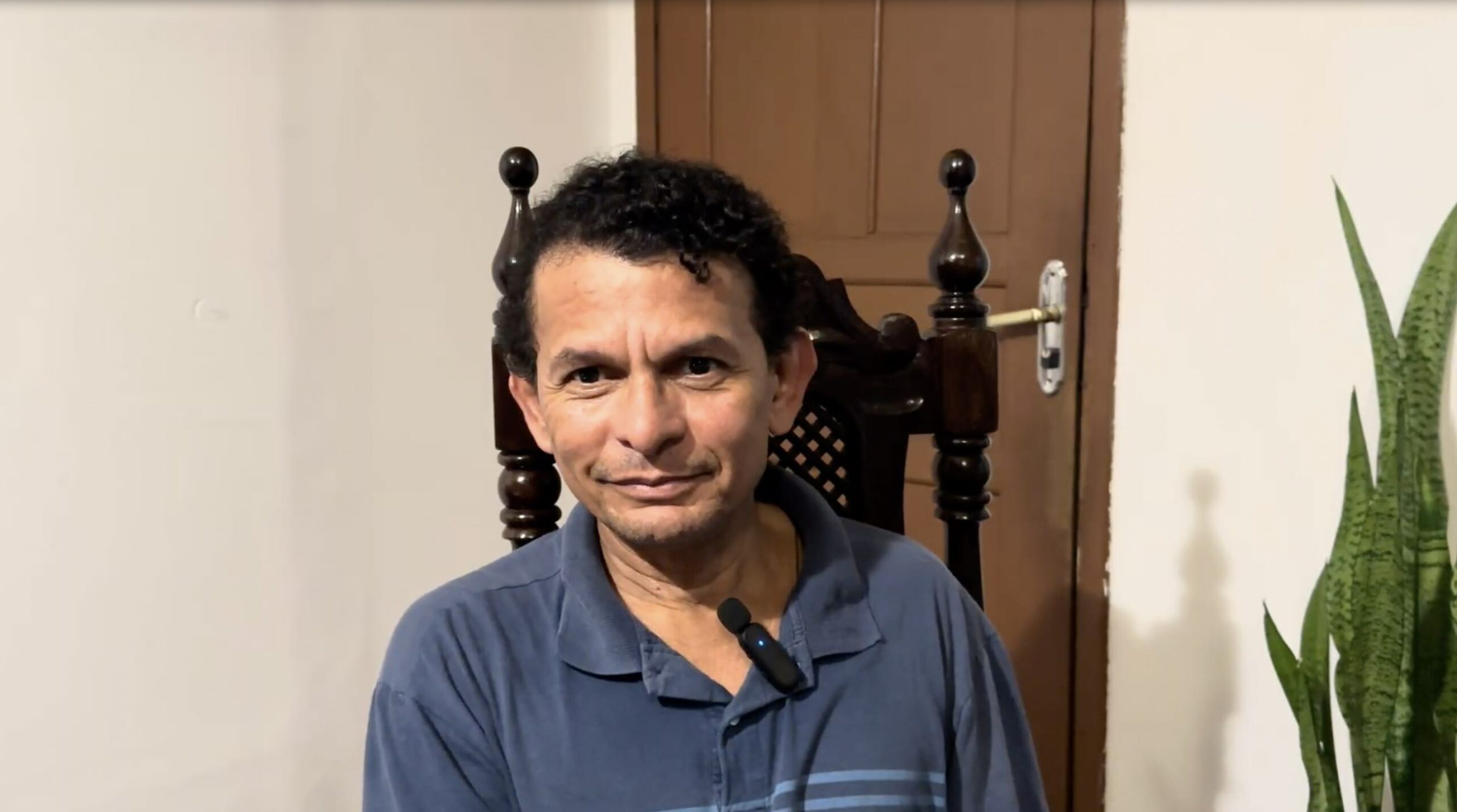À Curral da Igreja, au cœur de la municipalité d’Arari (Maranhão), Beth incarne une mémoire vivante de l’engagement communautaire pour l’accès à l’eau. Enseignante en éducation physique et présidente du comité de gestion du programme « Água para Todos », elle revient sur l’implantation d’un réseau de citernes, et sur la relation intime que les habitants entretiennent avec la rivière Mearim.
Une action communautaire au service de l’eau
« Je suis né ici, à Curral da Igreja, et j’y vis toujours. En parallèle de mon activité d’enseignante, j’assure la présidence du comité de gestion du programme Água para Todos. »
Ce programme, d’une importance capitale pour les habitants de la région, a permis l’installation de citernes de récupération d’eau de pluie d’une capacité de 16 000 litres. Ces dispositifs changent la vie dans un territoire où l’accès à l’eau potable est rare, voire inexistant. L’eau collectée sert tant à la consommation qu’à l’hygiène quotidienne.
« Nous avons toujours porté un attachement particulier à ces citernes, car elles représentent une ressource vitale. »
À l’origine, le comité était composé de dix-huit membres bénévoles. Aujourd’hui, seules trois personnes poursuivent cette mission — un signe, selon le professeur, des difficultés inhérentes à l’engagement social sans contrepartie financière.
Une mobilisation sans récupération politique
Le projet initial prévoyait l’installation de 370 citernes. Grâce à une gestion rigoureuse et à la mobilisation locale, ce sont finalement plus de 1 100 unités qui ont vu le jour dans 74 communautés de la région.
« Tout a commencé par une réunion d’information et d’inscription. Il est essentiel de souligner qu’aucun acteur politique, local ou régional, n’a été impliqué. Ce choix délibéré visait à garantir une mise en œuvre neutre et équitable. »
Le financement du projet provient du gouvernement fédéral brésilien, dans le cadre d’un programme destiné aux zones semi-arides. Bien que le Maranhão ne soit pas classé comme tel, certaines de ses municipalités — dont Arari — ont été incluses dans ce dispositif, probablement à la faveur de diagnostics locaux et de décisions politiques prises à l’échelle nationale.
« L’initiative fut pour nous une bénédiction. Elle s’est déroulée sans intervention des élus locaux, afin d’éviter toute récupération à l’approche des échéances électorales. »
La rivière Mearim, entre mémoire et transformations
Interrogé sur la rivière Mearim, Beth livre un témoignage sensible, mêlant souvenirs d’enfance et observations contemporaines.
« Le phénomène de la pororoca (phénomène naturel produit par la confrontation des eaux du fleuve avec celles de l’océan) a toujours existé ici. Il se produit à chaque pleine lune ou nouvelle lune, lorsque la marée montante remonte le fleuve. Autrefois, la rivière était plus étroite et plus profonde, et la force des vagues provoquait l’érosion des berges, emportant arbres et terres. »
Ces terres déplacées comblent peu à peu le lit du fleuve, ce qui accentue l’ensablement et modifie le comportement des marées. Ces bouleversements ont un impact direct sur les conditions de vie locales.
« Pour boire de l’eau, il fallait guetter la montée des eaux. Dès que la marée montait, nous courions remplir des bidons ou des seaux avant que l’eau ne devienne trop salée. »
Malgré ces contraintes, la rivière est restée pendant longtemps la source principale de subsistance.
« Nous vivions exclusivement de la pêche. Il n’y a jamais eu beaucoup d’agriculture ici. On lavait le linge sur les berges, on y passait nos journées. La rivière, c’était la vie. »
Des saisons marquées par le fleuve
Beth évoque avec précision les rythmes climatiques qui structurent la vie des communautés riveraines du Maranhão. Deux saisons dominent : un été sec, de juillet à décembre, et un hiver pluvieux, de janvier à juillet.
« Pendant l’hiver, il pleut abondamment, ce qui est plutôt bienvenu. Ce n’est pas cette période qui nous inquiète. En revanche, l’été est plus problématique. »
Le cycle saisonnier influe directement sur l’approvisionnement en eau. Longtemps, les habitants dépendaient exclusivement du fleuve pour toutes leurs activités domestiques, y compris l’eau potable. Aujourd’hui, des puits artésiens et des citernes facilitent l’accès à une eau de meilleure qualité.
« Nous utilisons désormais le puits pour les tâches domestiques, comme laver le linge, et nous buvons l’eau de la citerne. Avant cela, nous achetions de l’eau, quand nous le pouvions. »
Une biodiversité en déclin
Si le fleuve Mearim était autrefois une source inépuisable de poissons et de vie, la situation a changé.
« Depuis que les rizières ont été implantées dans la région, les poissons se font de plus en plus rares. Cela nous inquiète, car ici, nous vivons du fleuve. C’est notre source principale de subsistance. »
La déforestation des mangroves, opérée notamment pour la fabrication artisanale d’échafaudages de construction, aggrave le phénomène d’érosion. Les arbres, en protégeant les berges, jouaient un rôle de rempart contre les assauts du fleuve.
« Lorsqu’on coupe les arbres, les berges deviennent vulnérables. Avec les grandes marées, la vague heurte le rivage sans être freinée, emportant la terre. »
Quand le naturel se conjugue à l’industriel
Beth distingue clairement les phénomènes naturels, tels que la pororoca, d’autres facteurs aggravants liés à l’activité humaine : réchauffement climatique, raréfaction des pluies, incendies, et surtout pollution agricole.
« La pororoca a toujours existé, mais elle devient plus dévastatrice à cause de l’ensablement du fleuve, qui est accentué par l’érosion et la déforestation. »
Autrefois, le dragage du lit du fleuve permettait de limiter cet ensablement. Ce travail fédéral a cessé sans explication. Les machines sont toujours sur place, mais inactives.
« Nous redoutons que la rivière ne soit bientôt plus navigable, que la pororoca disparaisse, et que nous soyons définitivement coupés de notre environnement. »
L’impact du riz irrigué et des pesticides
Un tournant écologique majeur a été l’arrivée de producteurs venus du sud du Brésil, au début des années 2000, qui ont implanté des cultures de riz intensif irrigué.
« Toute l’eau utilisée vient du fleuve. Elle est prélevée par pompage, puis rejetée chargée de pesticides et de produits toxiques. Ces substances peuvent contaminer le sol pendant des siècles. »
Ces pratiques affectent lourdement la biodiversité et la santé des habitants.
« De nombreuses personnes souffrent de problèmes de peau ou d’estomac. Il n’y a pas de diagnostic officiel, mais nous savons que l’eau est contaminée. »
Le professeur déplore l’inaction des autorités publiques. Aucune initiative n’a été prise pour évaluer les impacts, malgré des alertes répétées.
« J’ai parlé à un ancien conseiller municipal. Il m’a répondu que ce poison tuait les parasites, mais qu’il n’y avait rien à craindre. Ce genre de réponse est inquiétant. »
Le silence des habitants et l’absence d’analyse
Face à la pollution, une forme d’impuissance collective s’installe.
« Certains riverains se taisent par peur, d’autres par manque d’informations. Et les autorités ne bougent pas. Pourtant, tout le monde sait. »
Une tentative d’analyse de la qualité de l’eau a été menée par une enseignante de l’Université d’État du Maranhão (UEMA). Les résultats étaient sans appel : l’eau du fleuve était impropre à la consommation, y compris pour les usages domestiques.
« Si nous pouvions obtenir des données scientifiques rigoureuses sur la toxicité de l’eau aux points de rejet des cultures de riz, cela pourrait déclencher une réaction. Il faut des preuves pour agir. »
L’urgence d’une éducation environnementale
Professeure engagée, Beth plaide pour une éducation à l’environnement dès le plus jeune âge, afin de sensibiliser la jeunesse aux enjeux qui les concernent directement.
« Les écoles ont déjà intégré certaines notions d’écologie, mais cela reste insuffisant. Il faut former des citoyens conscients et capables de défendre leur territoire. »
Éduquer les jeunes à leur rôle de citoyens du vivant
Dans un contexte de crise écologique et de désengagement institutionnel, Beth reste animée par une conviction ferme : former les jeunes générations à devenir les gardiens de leur territoire.
« Nous les emmenons voir la rivière pour leur montrer l’impact de chaque geste. Ils doivent comprendre qu’ils peuvent faire la différence, même par de petites actions. »
À travers son travail dans les écoles de la région, elle veille à éveille la conscience des enjeux écologiques.
« L’eau, même si elle n’est pas potable, reste précieuse. Et aujourd’hui, la marée salée remonte plus haut dans le fleuve qu’avant. Elle entraîne avec elle les pesticides rejetés en amont, jusque dans la mer. »
Un combat sans appui
Beth se heurte cependant à un mur : l’absence de soutien des pouvoirs publics, le manque de moyens, et l’inertie de certains acteurs locaux.
« Je ne sais pas si nous frappons aux mauvaises portes, ou si c’est la méthode qu’il faut revoir. Mais nous n’avons aucun appui. »
Malgré cela, elle refuse de renoncer. Le mot même d’« abandon » est pour elle à bannir du vocabulaire.
« Je dis toujours à mes élèves : ‘Abandonner est un verbe que nous ne devons jamais conjuguer.’ Même quand cela ne marche pas, il faut persister, dialoguer, chercher ensemble des solutions. »
Dialoguer avec les responsables et les pollueurs
Beth identifie clairement les responsabilités des cultures de riz intensives implantées par de grands exploitants venus d’autres régions.
« Trois ou quatre producteurs, venus du Sud, causent à eux seuls d’immenses dégâts.»
Elle ne les désigne pas comme ennemis, mais appelle à ouvrir le dialogue pour proposer des alternatives agricoles respectueuses de l’environnement. Des méthodes moins invasives existent, notamment dans un État comme le Maranhão, abondamment arrosé.
« Il y a des solutions. On peut cultiver sans ces pesticides qui tuent la terre pour 300 ans. Il faut vouloir les chercher, et pour cela, il faut parler. »
L’arme pacifique de l’interdisciplinarité
Pour Beth, l’éducation doit être transversale, ancrée dans la réalité quotidienne des élèves.
« Je dis à mes élèves : tu peux apprendre en jouant au basket sur la place du village. Mais à côté de toi, ton professeur de géographie t’explique le territoire, celui de portugais t’aide à bien parler, celui de sciences à comprendre ton corps. »
Elle milite pour une pédagogie active, collective, impliquant tous les enseignants dans un projet éducatif global : celui de faire de l’élève un acteur du changement, et non un simple récepteur de savoir.
« Ce que tu jettes par terre, ce n’est pas à l’autre de le ramasser. Tu es responsable. Et si tu comprends cela enfant, tu le transmettras autour de toi. »
Une pédagogie par l’exemple
Beth considère qu’enseigner va bien au-delà de la salle de classe. Elle intervient dans les rues, dans les villages, auprès des enfants et des familles. « Je leur dis : cette eau que vous avez dans la citerne, c’est une bénédiction. Elle ne tombe pas du ciel tous les jours. Ne la gaspillez pas. »
Ce rapport sacré à l’eau — don de la nature — structure sa pensée. Le projet des citernes, qu’elle décrit comme une œuvre collective précieuse, est aussi une expérience pédagogique : apprendre à gérer une ressource rare, à en comprendre la valeur.
« Nous sommes les gardiens de la citerne. 16 000 litres d’eau, c’est un trésor. »
Un message pour les générations futures
En guise de conclusion, Beth partage un message limpide, puissant, adressé à ses élèves comme à tous ceux qui l’écoutent :
« La planète, c’est notre maison. Il existe une autre façon de faire, plus juste, plus durable. Et pour cela, il faut parler. Le dialogue est notre meilleure arme. »
Elle rappelle que chaque génération a une responsabilité envers celle qui suit.
« Nous devons laisser une terre en état pour ceux qui viendront après nous. Si nous semons des graines saines aujourd’hui, elles donneront leurs fruits demain. »
Témoignages du même tableau