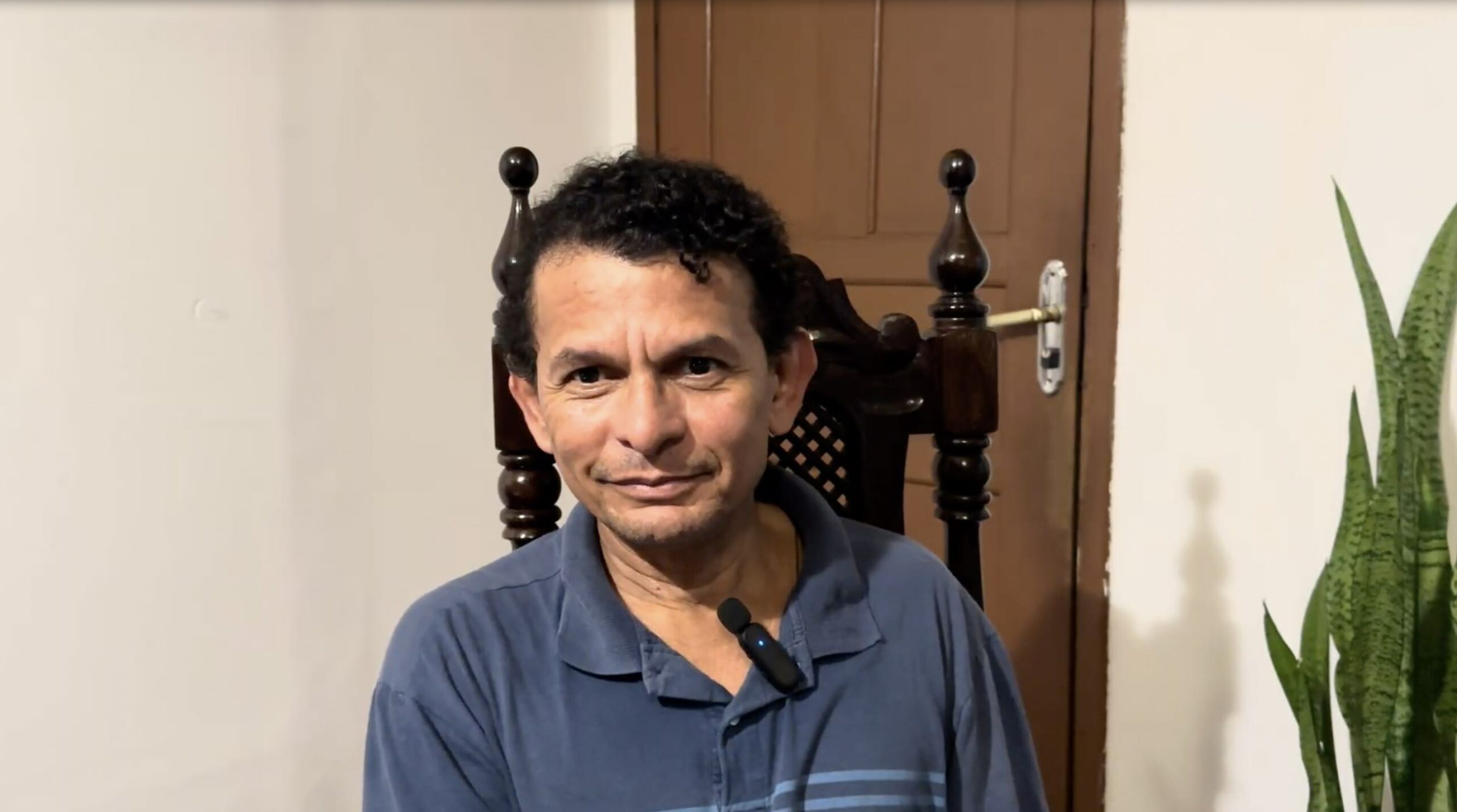Denilson Bezerra est professeur au département d’océanographie et de limnologie de l’Université fédérale du Maranhão. Il consacre ses recherches à l’élévation du niveau de la mer au Brésil, et plus particulièrement à l’évolution des mangroves, qu’il étudie comme bio-indicateurs des transformations climatiques.
« La mangrove, comme on dit, est l’indicateur de l’élévation du niveau de la mer. »
Selon lui, cet écosystème de transition entre mer et continent réagit directement aux modifications du niveau marin : elle peut reculer, migrer vers l’intérieur des terres ou résister à l’érosion côtière. Le Brésil abrite la plus grande bande continue de mangroves au monde, s’étendant du Maranhão au Pará et à l’Amapá, dans ce que l’on appelle l’Amazonie légale. « Le Brésil possède la plus grande zone continue de mangroves amazoniennes », précise-t-il.
Des données insuffisantes pour évaluer l’ampleur du phénomène
Denilson souligne le manque de données précises sur l’élévation du niveau de la mer au Brésil : « Nous n’avons pas de suivi mesuré de l’augmentation de la colonne d’eau dans la mer. » Actuellement, seules les images satellites et la télédétection permettent d’en estimer l’évolution.
Cependant, ses observations de terrain dans la région de la Baixada Maranhense révèlent des modifications significatives. Cette zone de lagunes d’eau douce voit désormais l’intrusion croissante d’eau salée, altérant tout l’écosystème local : « Des zones autrefois douces deviennent saumâtres. » Il ajoute : « Nous commençons à remarquer un changement dans la faune piscicole. » Les poissons d’eau douce cèdent la place à des espèces estuariennes, affectant directement la pêche traditionnelle ».
Impacts sur la santé et la vie quotidienne
Ces transformations ont des conséquences directes sur la population. Denilson alerte sur la salinisation des nappes phréatiques : « Autrefois, les gens foraient des puits près des rivières et buvaient l’eau. Aujourd’hui, la rivière devient saumâtre. » Il évoque une recrudescence de maladies liées à cette contamination, notamment l’hypertension.
À São Luís, capitale du Maranhão, il constate que les marées deviennent de plus en plus agressives : « Les vagues sont plus agressives, nous voyons déjà un impact même sur le tourisme. » Des constructions sont menacées, les plages érodées, et de nouvelles mangroves apparaissent dans des zones auparavant urbaines. « Ce n’est pas nécessairement une bonne chose, mais c’est une indication. »
Une société en éveil, mais encore peu préparée
Selon Denilson, la société commence à prendre conscience du problème. « Le secteur privé lui-même \[…] fait directement appel à l’université pour faire des études sur l’élévation du niveau de la mer. » Il insiste sur ce changement : l’ingénierie urbaine se tourne désormais vers les chercheurs pour anticiper les risques.
Malgré cette évolution, il considère la région comme vulnérable : « Ce qu’il manque ? L’élévation du niveau de la mer est un fait, les gens vont subir cet impact, nous devons préparer la société à le recevoir. » Il appelle à des politiques publiques anticipatrices, en matière d’éducation, de santé, d’infrastructures et de relogement des populations les plus exposées.
« Nos ponts peuvent-ils résister à l’avancée de la mer ? », s’interroge-t-il, évoquant notamment le pont Francisco ou les habitations sur pilotis. Il propose un programme d’adaptation global : « Un programme de formation pour ces personnes, en d’autres termes, un programme d’adaptation complet. »
S’adapter, car le retour en arrière n’est plus possible
Pour Denilson, il ne s’agit plus de prévenir un phénomène, mais de s’adapter à une réalité inéluctable. Il évoque la topographie basse de l’île de São Luís et la fréquence des phénomènes extrêmes : inondations, incendies, tsunamis météorologiques. Ces événements, de plus en plus fréquents, rendent la situation critique.
Ses travaux de modélisation montrent que l’ensemble de la façade littorale de São Luís devra être repensée : « Les hôtels devront être déplacés, des ressources von devoir être allouées pour déplacer les bâtiments d’un endroit à un autre. »
« Le secteur privé lui-même \[…] fait directement appel à l’université pour faire des études sur l’élévation du niveau de la mer. » Malgré cette évolution, il considère la région comme vulnérable.
L’implication croissante des pouvoirs publics
Denilson observe une évolution progressive de la posture des pouvoirs publics :
Le gouvernement du Maranhão, le gouvernement de l’État et les municipalités essaient de comprendre ce qui se passe. »
Si les premières années de sa carrière universitaire étaient davantage centrées sur l’ingénierie et la pêche, depuis 2020, il constate un intérêt croissant pour les effets du changement climatique. L’université est désormais régulièrement sollicitée pour participer à des plans nationaux, comme celui de lutte contre les incendies et la sécheresse, ou à des réunions d’experts portant sur l’évolution des zones basses du littoral :
« Ils font appel aux universités – publiques, privées, étrangères – pour comprendre ce qui se passe réellement dans notre zone côtière. »
Des politiques en construction : de la législation à l’adaptation
Face aux enjeux, des réflexions sont en cours pour adapter la législation :
« Ils réfléchissent déjà à une législation visant à lutter contre l’élévation du niveau des mers. »
Des politiques de crédits carbone sont envisagées. Si tout est encore en phase exploratoire, Denilson relève un fait majeur : « Le grand point positif que je vois, c’est que les gestionnaires publics sont sensibilisés à la discussion. »
Il cite le Programme pour l’eau douce (PAD), porté par le gouvernement du Maranhão avec le soutien fédéral, comme un exemple d’action concrète. Ce programme cible les communautés rurales touchées par la salinisation de l’eau douce. Il prévoit l’installation de mini-usines de désalinisation et la formation des habitants à leur usage.
Reconnaître l’ampleur du défi : un travail de fond à mener
Denilson insiste cependant : « Nous n’en sommes qu’au début. »
Le littoral du Maranhão est immense, et 47 % des mangroves brésiliennes s’y trouvent. Il appelle à une compréhension approfondie de la situation pour éviter que les actions menées ne soient de simples solutions d’urgence.
Un changement de paradigme porté par les nouvelles générations
Denilson observe une transformation importante depuis les élections de 2018 :
« Jusqu’en 2018, beaucoup de gens remettaient en question le changement climatique, le traitaient d’idéologie. Aujourd’hui, ce discours a totalement changé. » Il évoque l’importance du débat, désormais plus apaisé et transversal, jusque dans les universités. Et surtout, il souligne la conscience croissante des plus jeunes :
« Les enfants d’aujourd’hui, au début du XXIe siècle, seront les prochains adultes, les futurs gestionnaires, activistes ou scientifiques. »
Il note que la consommation change : « J’ai grandi dans une génération de consommation extrême. Aujourd’hui, les enfants sont déjà éduqués, à la maison comme à l’école, à repenser leur consommation. »
L’éducation comme levier de transformation
Denilson participe également à des actions éducatives concrètes. L’université fédérale (UFMA) travaille avec des écoles sur ces questions : « Nous présentons nos modèles de simulation de l’élévation du niveau de la mer, calculés jusqu’en 2100, avec des images satellites. »
Ces outils sont utilisés pour sensibiliser les élèves à travers des supports visuels percutants. Pour lui, le climat est un sujet qui ne peut plus être ignoré : « Ce n’est pas un programme de gauche ou de droite. C’est un programme d’humanité. »
Et de conclure avec espoir :
« La première étape est de reconnaître qu’il y a un problème. Aujourd’hui, les gens sont sensibilisés, et cela génère un processus de prise de conscience. »
Témoignages du même tableau