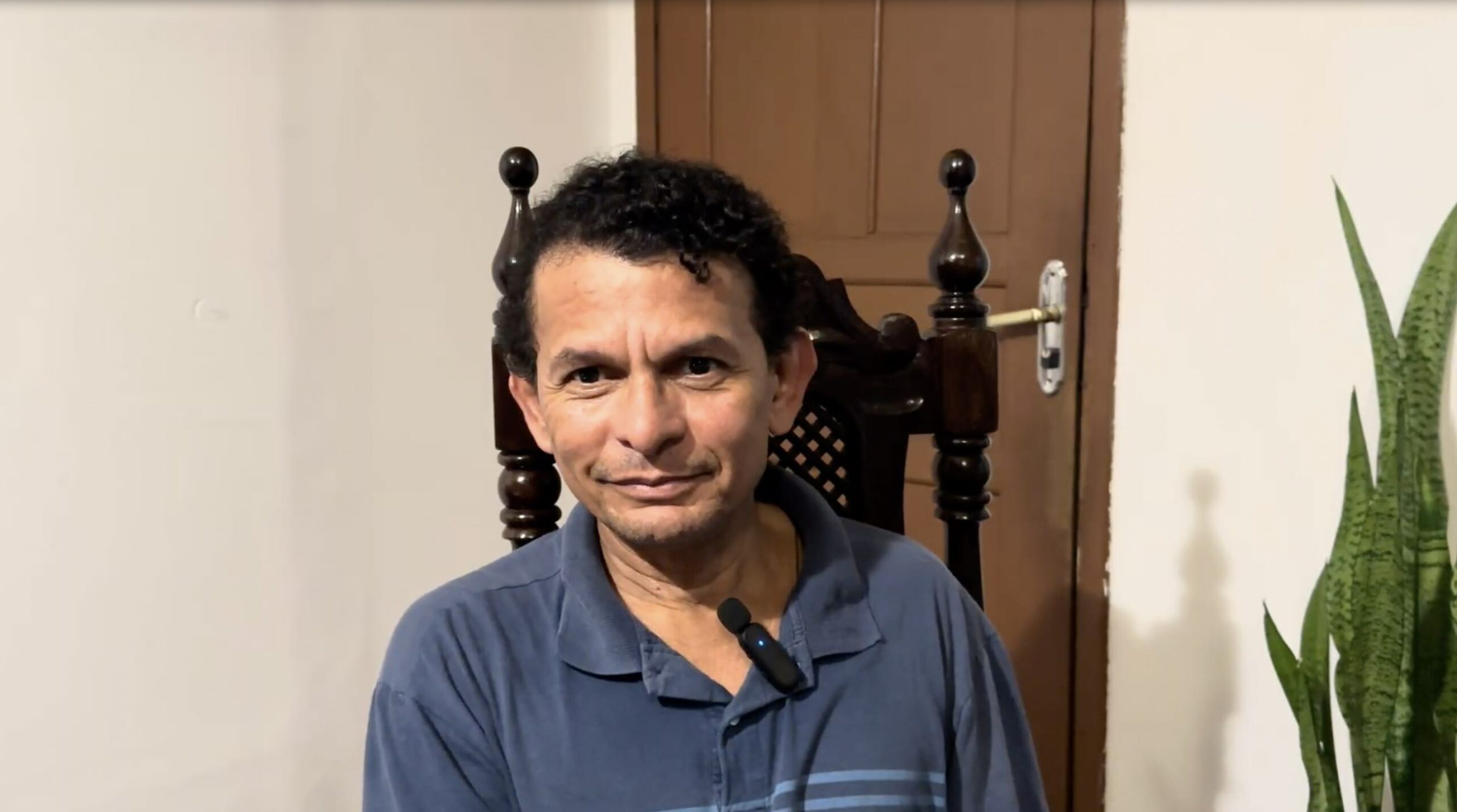Antônia est pêcheuse et mère de 5 enfants. Elle vit au rythme du fleuve depuis toujours. Issue d’une famille de pêcheurs, elle a très tôt affirmé son refus de travailler dans les champs, préférant la pêche et la collecte de noix de coco. « Depuis mon enfance, je n’ai jamais aimé l’agriculture. Mes parents ne nous emmenaient pas dans les champs. On cassait des noix de coco et on pêchait. » Après son mariage, c’est son époux qui a choisi l’agriculture. Elle, naturellement, a poursuivi la voie de la pêche. Aujourd’hui, cette activité est transmise à ses enfants, sans distinction de genre : « Toute ma famille est pêcheuse, les hommes comme les femmes. »
Malgré des problèmes récents de santé, elle continue de pêcher dès que son état le lui permet : « Grâce à Dieu. Aujourd’hui, je me suis même levée en me sentant mieux».
Une pratique diversifiée et résiliente
Interrogée sur ses techniques de pêche, Antônia précise utiliser différents outils selon les conditions du fleuve et les espèces ciblées : « Je pêche à la ligne, avec un choc — avec ma main —, en prenant le poisson… avec tout. De toutes les façons possibles. Je ne meurs pas de faim. »
Le « choc » qu’elle mentionne désigne une technique artisanale consistant à piéger les poissons à la main dans la boue, en les repérant au toucher. Elle manie aussi bien les filets que la ligne, sauf la flèche, qu’elle ne pratique pas.
Changements écologiques et impacts sur la pêche
Au fil des années, Antônia a été témoin de transformations notables dans l’environnement. Elle évoque l’assèchement des zones de pêche traditionnelles, en particulier les lacs temporaires : « L’endroit où nous pêchions ici est presque entièrement asséché aujourd’hui. Il n’y a plus d’endroit où pêcher. »
L’origine de ces changements ? La sécheresse prolongée : « À cause de l’été, qui est très long, tout s’assèche. » Elle confirme que désormais, seule la rivière reste praticable.
Concernant l’état de l’eau, elle évoque des épisodes de pollution ponctuelle liés aux pratiques agricoles en amont : « Cette eau dans laquelle ils mettent le poison… c’est mauvais pour l’eau, c’est mauvais pour nous. On ne boit même plus l’eau de la rivière. » Aujourd’hui, l’eau potable provient d’une citerne remplie en saison des pluies.
Elle précise que si cette pollution n’a pas encore provoqué de mortalité massive des poissons, un autre phénomène naturel cause, lui, de véritables dégâts : la pourriture organique des sols lessivés par les premières pluies : « En décembre, il commence à pleuvoir et l’eau des champs pourrit tout. (…) Dans la rivière, on sent vraiment l’odeur d’une vieille digue pourrie. Puis beaucoup de poissons meurent. »
Ce phénomène, connu scientifiquement comme une eutrophisation, est reconnu localement sous le nom de « balceiro » — un mélange d’eaux stagnantes et de matières organiques en décomposition. « C’est ce qu’on appelle de l’eau pourrie. (…) L’eau de la rivière devient boueuse et les poissons meurent, comme ivres. »
Antônia distingue cependant ce phénomène naturel de la pollution issue des rizières : « Ce sont deux choses différentes. C’est le transport de matière organique et de l’excès dans la rivière. »
Une pêche encadrée mais fragile
Comme tous les pêcheurs locaux, Antônia est soumise à la période de l’interdiction de pêche, liée à la reproduction des poissons : « Elle commence le 20 décembre et va jusqu’au 20 mars. (…) Si on ne respecte pas l’interdiction, le permis est suspendu et nous payons une amende. » Pendant cette période, elle survit grâce à sa pension.
Lumières sur le fleuve : récits, foi et transmission
Antônia ne tarde pas à évoquer une apparition mystérieuse, survenue lors d’une nuit de pêche. « Je l’ai vue dans la rivière en pêchant la nuit. Une lumière est apparue sur un bâton. Je n’ai pas eu peur, parce que j’ai pensé que c’était une ampoule. Elle a grandi, elle est devenue rouge, rouge, rouge. » Elle raconte avoir observé longuement cette lumière avant de décider de partir, sans véritable frayeur. Je l’ai vue, mais je n’y ai pas prêté attention. »
Attachée à sa pratique, elle refuse que ce type d’événement surnaturel l’empêche de sortir pêcher : « Je n’ai pas peur. J’aime trop la pêche. (…). Que la lune soit belle ou pas, une seule chose compte : la pêche. »
À la question de savoir si d’autres personnes ont été témoins d’apparitions étranges, Antônia confirme : « D’autres personnes l’ont vue aussi. Certains ont vu la rive en feu, à l’intérieur de l’eau.» Elle rapporte aussi le témoignage d’un homme, Antônio Pedro, dont le fils aurait vu un aningal – terme qui désigne des zones de végétation aquatique dense- en feu dans la rivière.
Pour Antônia, ces phénomènes n’appellent ni peur ni interprétation mystique : « Je suis une personne qui a beaucoup de foi. Si je vois quelque chose, je veux le voir jusqu’au bout pour comprendre ce que c’est. (…) Parfois, on entend un bruit, on croit que c’est un visage ou autre chose, mais souvent ce ne sont que des animaux. Moi, j’aime voir pour croire. »
Prière pour la rivière
Lorsqu’on lui demande ce qu’elle souhaite pour l’avenir de la rivière et de la pêche, Antônia exprime une inquiétude profonde : « La seule chose que je me dis, c’est que nous allons perdre cette rivière, qu’elle va s’assécher. Je prie vraiment Dieu pour que cela n’arrive pas, parce que c’est là que nous trouvons notre pain quotidien. »
Elle constate une baisse alarmante des précipitations : « Cela fait presque six mois que personne ne sait plus ce que c’est qu’une goutte d’eau qui tombe… Il n’y a que du soleil. » Selon elle, même les fines pluies saisonnières se font rares : « Il y a trois mois, il y a eu un crachin. C’est tout. Il n’y en a pas eu d’autre depuis. »
Elle alerte sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir la disparition du fleuve pour les communautés riveraines : « Si une rivière comme celle-là s’assèche, cela va tout tuer. (…) C’est notre survie qui en dépend. S’il n’y a plus de rivière, nous sommes perdus. »
Transmission et gratitude
Interrogée sur l’avenir de la pêche dans sa famille, Antônia assure que la tradition se perpétuera avec ses enfants et petits-enfants. Évoquant son rôle de cheffe de famille, elle revient sur les difficultés traversées avec dignité : « J’ai élevé mon fils en me battant trop souvent avec mon partenaire. (…) Quand il partait aux champs, moi je restais à la maison, je cassais des noix de coco et je pêchais. »
Elle évoque ses journées bien remplies, levée à l’aube, organisant les tâches domestiques, les repas, les bains des enfants, et trouvant malgré tout le temps de pêcher matin et soir. L’éducation des enfants porte ses fruits : certains ont poursuivi des études, l’un d’eux étant même devenu médecin.
Depuis le décès de son mari, survenu en octobre, elle continue d’assumer seule la charge de la famille, mais elle témoigne d’une profonde gratitude : « Grâce à Dieu, Notre Dame, ils m’ont toujours obéi. (…)Je suis heureuse de ce que Dieu m’a donné. »
Témoignages du même tableau