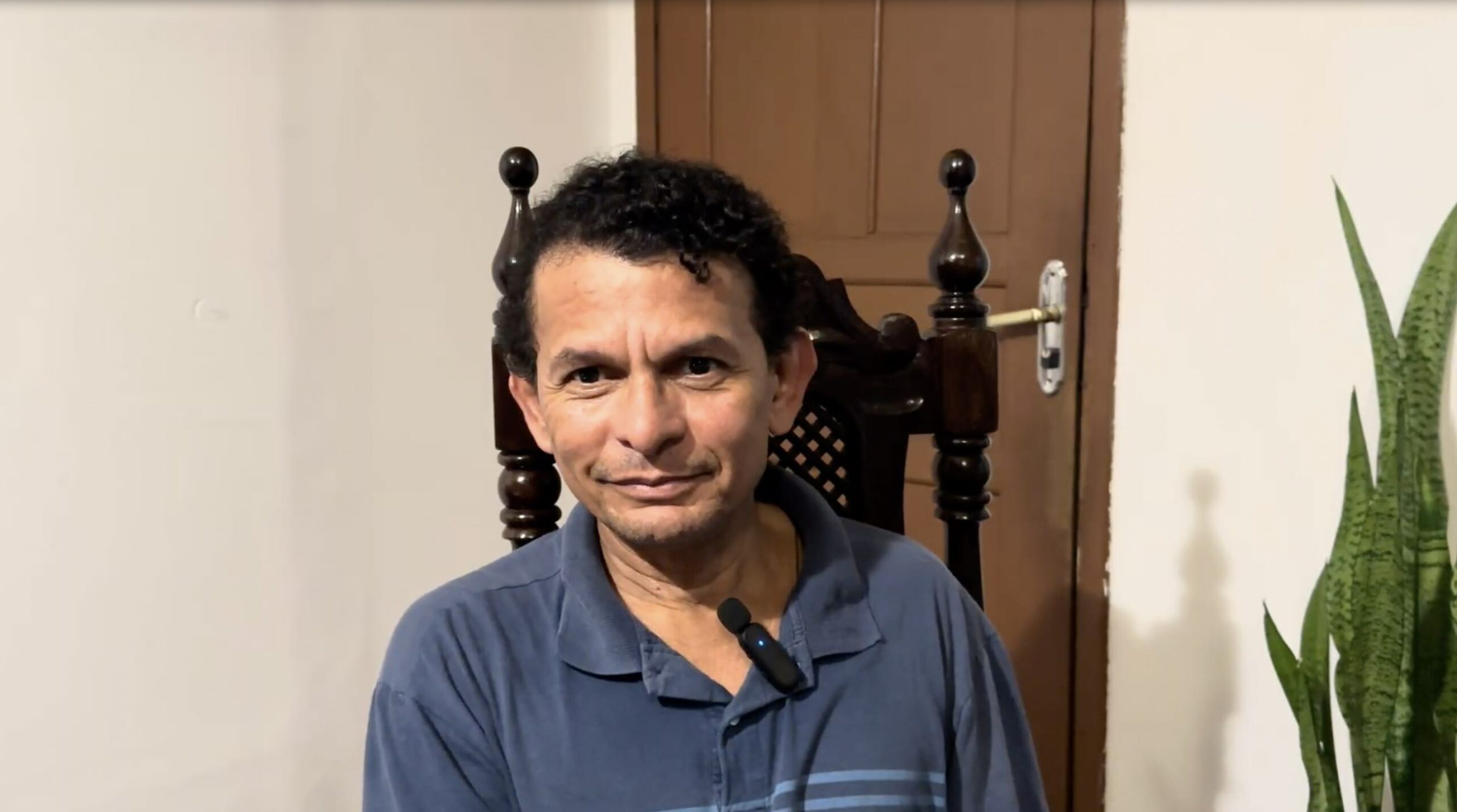Irasci Correa Santos Vieira a 69 ans. Née et élevée dans son village, elle a consacré 32 années de sa vie au service de la municipalité avant de prendre sa retraite. Aujourd’hui, elle s’occupe de ses petits-enfants et continue de vivre au rythme de la communauté, témoin actif de son évolution.
Les transformations de la rivière
Depuis son enfance, Irasci a observé de profondes transformations dans le paysage et les équilibres écologiques locaux.
Elle explique : « Il y a des changements dans la rivière, il y a des changements, beaucoup de changements. » Autrefois, la mangrove était absente de la zone ; elle est apparue avec le temps, à mesure que la rivière perdait en profondeur. « Ce palétuvier vient de l’embouchure de la rivière, il est donc né là-bas. Avant, cette mangrove n’existait pas. »
Le changement de salinité de l’eau est un autre fait marquant. « L’eau est devenue plus salée qu’avant. » Cette évolution a eu des conséquences directes sur les usages quotidiens : pendant longtemps, les habitants collectaient l’eau de la rivière à marée montante pour la boire. « Nous ramenions l’eau de la rivière à la maison et la gardions dans nos réservoirs pour la boire pendant 15 jours, et nous devions l’économiser. »
Un bouleversement des pratiques et des ressources
Cette habitude de collecte de l’eau a disparu il y a environ 35 ans, en raison de la salinisation accrue et de la baisse de qualité de l’eau. « Aujourd’hui, ce n’est plus la peine, parce que l’eau ici est salée, même pendant la saison des pluies. » Un puits artésien a été creusé il y a environ 30 ans, offrant une eau partiellement utilisable pour les besoins domestiques. « C’est de l’eau salubre, nous l’utilisons pour laver les vêtements, pour cuisiner mais nous ne pouvons pas faire de café. » L’eau potable provient aujourd’hui de citernes, devenues essentielles.
La baisse du niveau de la rivière a également entraîné une chute drastique de la biodiversité aquatique. Autrefois, les poissons étaient nombreux, accessibles depuis les berges. « Il y avait beaucoup de poissons ici, n’importe où sur la rivière. \[…] Cette rivière était profonde. » Aujourd’hui, cette abondance appartient au passé.
Une inquiétude pour l’avenir
Face à ces transformations, Irasci exprime une vive inquiétude pour les générations futures. « Je sais ce que j’ai vécu, je sais ce que je vis, mais je pense à mes enfants, à mes petits-enfants. » Elle constate la raréfaction du poisson et l’absence d’actions des autorités : « Nous pourrions espérer que nos gouvernements fassent quelque chose, mais personne ne fait rien. » Si des habitants ont quitté la communauté, ce n’est pas toujours en raison directe de la dégradation environnementale, mais plutôt dans l’espoir d’une meilleure qualité de vie en ville.
La mémoire d’un territoire en mutation
Dans la suite de son témoignage, Irasci évoque des changements géomorphologiques précis de la rivière. Elle se souvient d’une époque où le lit du fleuve était sinueux et profond, et où les embarcations suivaient ses courbes naturelles. Mais sous la pression des pêcheurs et des embarcations légères, ces courbes ont été progressivement « coupées » pour gagner du temps. Résultat : le cours de la rivière a été modifié, les berges fragilisées, et la profondeur a diminué.
Autrefois, on observait une faune aquatique abondante : « Il y avait de gros poissons et beaucoup de marsouins. \[…] Quand il y avait beaucoup de poissons, des poissons éponges, des gros poissons, les marsouins venaient. » Aujourd’hui, ces espèces ont pratiquement disparu.
Des nuisibles en augmentation, des prédateurs discrets
Au fil des années, un autre changement est perceptible : l’évolution des espèces présentes dans l’environnement immédiat. Si les caïmans sont désormais rares — « Les alligators, on ne les voit que dans la rivière. Il n’y a pas d’alligators ici pour nous maintenant. » — en revanche, les insectes prolifèrent.
En particulier, le « maruim », un minuscule moustique quasi invisible, est devenu omniprésent : « Il y en a tellement que si vous partez d’ici à 5 heures du matin, vous ne resterez pas dehors. \[…] La piqûre fait plus mal qu’un taon. » Ces insectes prolifèrent dans les zones stagnantes où l’eau salée remonte et dépose des feuilles en décomposition.
Le recul de la mer, la progression de la mangrove
La mangrove, absente autrefois, progresse chaque année. Irasci l’explique par la montée des eaux et l’intrusion saline : « La mer entre de plus en plus par l’embouchure de la rivière \[…] et chaque fois qu’elle arrive, elle tue la végétation. » Ce bouleversement écologique transforme profondément les paysages : « Je plaisante même sur le fait qu’à l’avenir, les pêcheurs deviendront des ramasseurs de crabes ! »
Apparitions animales inhabituelles
Irasci raconte aussi la découverte surprenante d’un animal marin de grande taille, proche du phoque, qui s’était échoué dans la région. Elle a alerté les écologistes locaux pour tenter de le sauver : « Je l’ai trouvé. J’ai ensuite appelé les écologistes d’Arari. »
Adaptations locales : apiculture et pisciculture
Face à la raréfaction des poissons et à la salinisation croissante de l’eau, les habitants développent de nouvelles stratégies. L’apiculture, par exemple, s’est implantée dans certaines familles : « Il y a de l’élevage d’abeilles. \[…] Mais cela fait un an que je n’ai pas eu de miel, parce qu’il n’y a pas de fleurs. »
La pisciculture connaît aussi un essor, malgré les difficultés liées à l’eau : « Les poissons que nous élevons ici sont le pacu-manteiga, le tilapia, le curimatã et le tambatinga. » Mais l’eau utilisée est exclusivement de l’eau de pluie : « Parce que l’eau de la rivière est salée, il n’y a pas moyen de l’utiliser. »
Un poisson non indigène, le piramutaba, a également colonisé la zone récemment : « Ce n’est pas un poisson d’eau douce, mais il est arrivé ici grâce à Dieu. \[…] On en voit beaucoup en ce moment. » Cependant, il divise les opinions : sa chair est jugée peu savoureuse par une partie de la population.
Un quotidien réorganisé autour de la rareté
La préparation des repas repose exclusivement sur l’eau de pluie collectée. « Le repas qu’on fait, c’est uniquement avec de l’eau de pluie. \[…] C’est un cadeau du ciel. »
Témoignages du même tableau