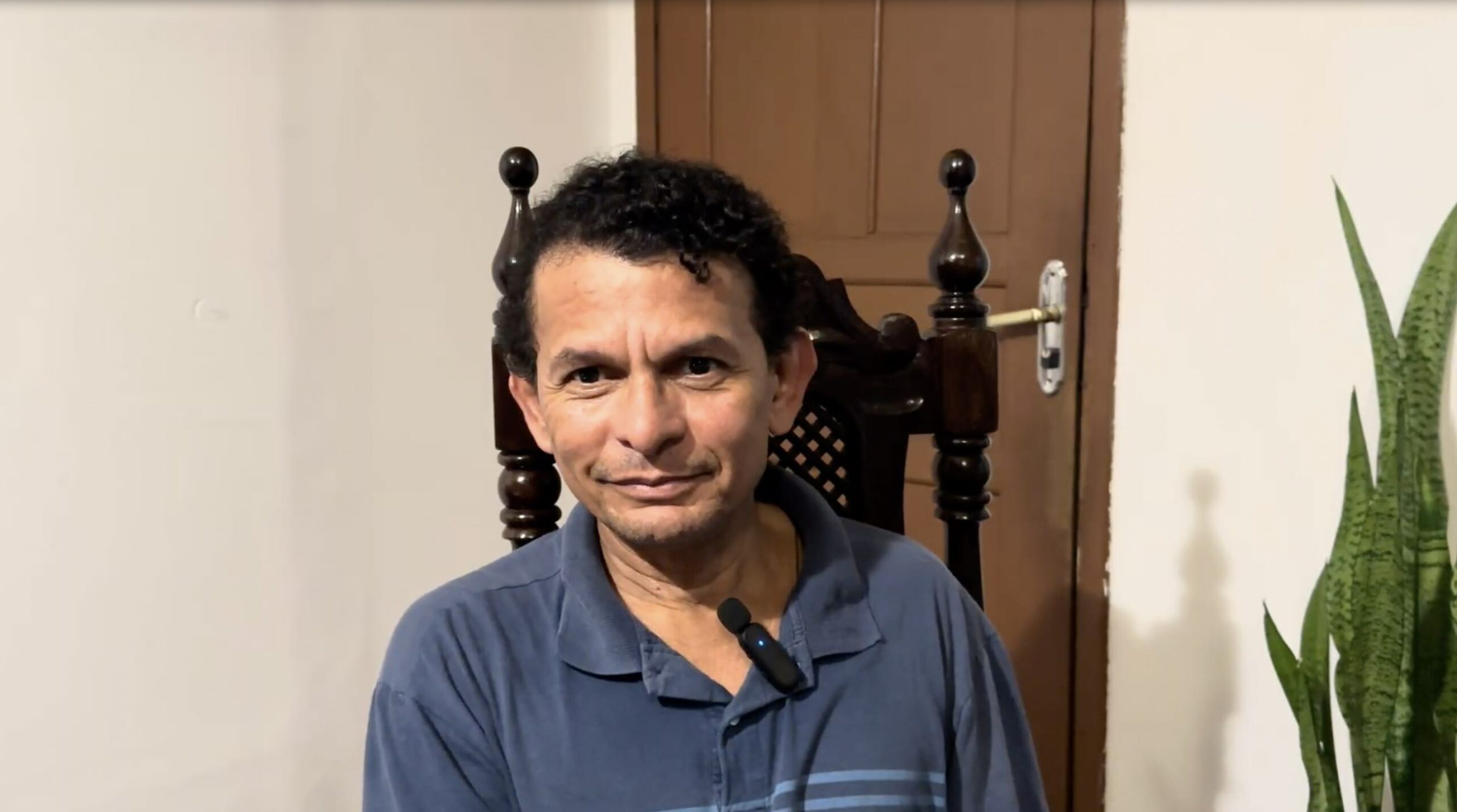Dans cet entretien, Anne Justino, post-doctorante à l’Université rurale fédérale de Pernambuco (UFRPE) au Brésil, revient sur son parcours de recherche centré sur les contaminations microplastiques dans les écosystèmes marins. À travers ses travaux menés dans le cadre du projet LMI Tapioca – un laboratoire de recherche franco-brésilien en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) – elle met en lumière l’inquiétante présence de particules plastiques dans les tissus musculaires de poissons consommés par l’homme, tels que le thon. Elle alerte ainsi sur les potentielles conséquences sanitaires de cette pollution invisible.
Une contamination généralisée et des recherches inédites
Anne Justino mène ses recherches dans le cadre du projet LMI Tapioca, réunissant des chercheurs brésiliens et français pour analyser la présence de microplastiques dans les écosystèmes marins du nord-est du Brésil. Ce programme de recherche porte sur des zones variées : les environnements côtiers, estuariens et même les profondeurs océaniques.
« Nous avons trouvé beaucoup de contamination dans toutes les zones que nous avons étudiées, y compris dans les environnements océaniques profonds. »
Des espèces telles que les céphalopodes ou certains poissons mésopélagiques présentent des niveaux de contamination particulièrement élevés, ce qui révèle l’ampleur du phénomène jusque dans les zones les moins accessibles.
Le rôle du niveau trophique dans l’accumulation des microplastiques
L’analyse des chaînes alimentaires a permis à la chercheuse d’identifier un facteur majeur d’aggravation : le niveau trophique des espèces. « Si un thon se nourrit de sardines contaminées, son estomac contiendra bien plus de microplastiques que ceux des sardines elles-mêmes. »
Ce phénomène d’accumulation s’explique par la consommation successive d’organismes déjà porteurs de particules plastiques, renforçant l’exposition des poissons prédateurs.
Des microplastiques jusque dans les tissus musculaires
La particularité des recherches d’Anne Justino réside dans l’identification de particules plastiques non seulement dans le système digestif, mais aussi dans les tissus musculaires des poissons – en particulier ceux consommés par l’homme, comme le thon. « Nous avons déjà identifié des polymères plastiques dans les tissus musculaires de thons. »
Ces analyses, menées en collaboration avec des laboratoires norvégiens, utilisent des techniques de chromatographie pour isoler et identifier les polymères présents dans les échantillons biologiques.
Un impact documenté chez les poissons, mais incertain chez l’homme
Si les effets délétères des microplastiques sur la faune marine sont déjà documentés (troubles physiologiques, déséquilibres de flottaison, etc.), leur impact sur la santé humaine reste encore à démontrer.
« Nous savons que les poissons souffrent des microplastiques, mais pour les humains, c’est encore un mystère. »
L’absence de recherches longitudinales sur les humains rend difficile l’établissement d’un lien clair entre ingestion de poissons contaminés et effets sanitaires mesurables. En revanche, des études sur de petites espèces animales montrent des altérations biologiques significatives.
Une recherche encore récente, mais urgente
Avec seulement deux décennies de recul, la recherche sur les microplastiques en est encore à ses débuts. Mais les résultats disponibles suffisent à alerter sur une pollution persistante et omniprésente, nécessitant une réponse collective urgente.
« Vingt ans de recherche, ce n’est pas grand-chose. Mais nous savons déjà que le plastique est partout. »
La fragmentation du plastique : un défi environnemental persistant
Anne Justino rappelle que les microplastiques sont souvent issus de la dégradation de plastiques de plus grande taille. Ces derniers, soumis aux intempéries et à l’érosion naturelle, se fragmentent progressivement jusqu’à devenir invisibles à l’œil nu, tout en conservant leur impact écologique.
« Ce qui se passe, c’est que le plastique devient de plus en plus petit, sans jamais disparaître vraiment. »
Ces particules, présentes aussi bien dans les fonds marins que dans l’air ambiant, s’accumulent et échappent à toute forme de traitement classique.
Traitements et limites technologiques
En Europe, certaines villes ont commencé à mettre en place des systèmes de filtration dans les stations d’épuration pour retenir les particules plastiques avant qu’elles n’atteignent les rivières et les océans. Ce n’est pas encore le cas au Brésil, où ces dispositifs restent très rares.
« Ici, au Brésil, nous n’en sommes encore qu’au tout début. Seules quelques villes ont mis en place des grilles pour bloquer les plastiques les plus gros. »
Des barrières simples, comme des grilles, sont parfois installées, mais leur efficacité reste limitée.
Des solutions biotechnologiques prometteuses, mais encore expérimentales
La recherche explore actuellement des pistes prometteuses, notamment l’utilisation d’enzymes capables de dégrader certains polymères plastiques. Ces enzymes, étudiées notamment par des équipes japonaises, ne peuvent toutefois être utilisées que dans des environnements strictement contrôlés.
« Ces enzymes ne peuvent pas être libérées dans la nature : elles doivent être utilisées dans des centres spécialisés pour éviter d’endommager les écosystèmes. »
Leur application directe en mer est pour l’instant exclue, en raison de leur impact potentiel sur la biodiversité marine.
Vers une réduction à la source : prévention et législation
Pour Anne Justino, la véritable solution réside en amont, dans la réduction de l’utilisation du plastique et la mise en place de législations restrictives. Elle évoque l’interdiction des plastiques à usage unique, comme les pailles ou les gobelets jetables, déjà effective dans certaines régions.
« Nous devons repenser nos modes de consommation, car le recyclage ne suffira pas à rattraper la production actuelle de plastique. »
Une législation plus ambitieuse et un changement profond des habitudes de consommation apparaissent comme indispensables.
L’éducation, moteur du changement
La chercheuse insiste sur le rôle clé de l’éducation dans la lutte contre la pollution plastique. En expliquant les conséquences de l’usage excessif du plastique, elle espère éveiller les consciences, dès le plus jeune âge.
« Lorsqu’on explique pourquoi il n’est pas bon d’utiliser autant de plastique, les gens comprennent et changent leurs habitudes. »
Elle défend une éducation non moralisante, mais fondée sur la transmission d’informations concrètes et scientifiquement étayées.
Restituer la science aux communautés locales
Anne Justino accorde une importance particulière à la transmission des savoirs scientifiques aux populations directement concernées, notamment les communautés de pêcheurs. Elle organise régulièrement des échanges pour les sensibiliser aux impacts de la pollution sur leur environnement immédiat.
« Nous allons à la rencontre des communautés pour leur transmettre ce que nous découvrons à l’université. C’est ensemble que nous pouvons changer les choses. »
Cette approche participative vise à renforcer la résilience des territoires côtiers, tout en valorisant le rôle actif des populations locales dans la préservation des océans.
Note : les recherches concernant les polymères plastiques dans le tissu musculaire des thons sont toujours en cours d’évaluation par les auteurs et seront bientôt soumises pour publication dans une revue scientifique.
Témoignages du même tableau