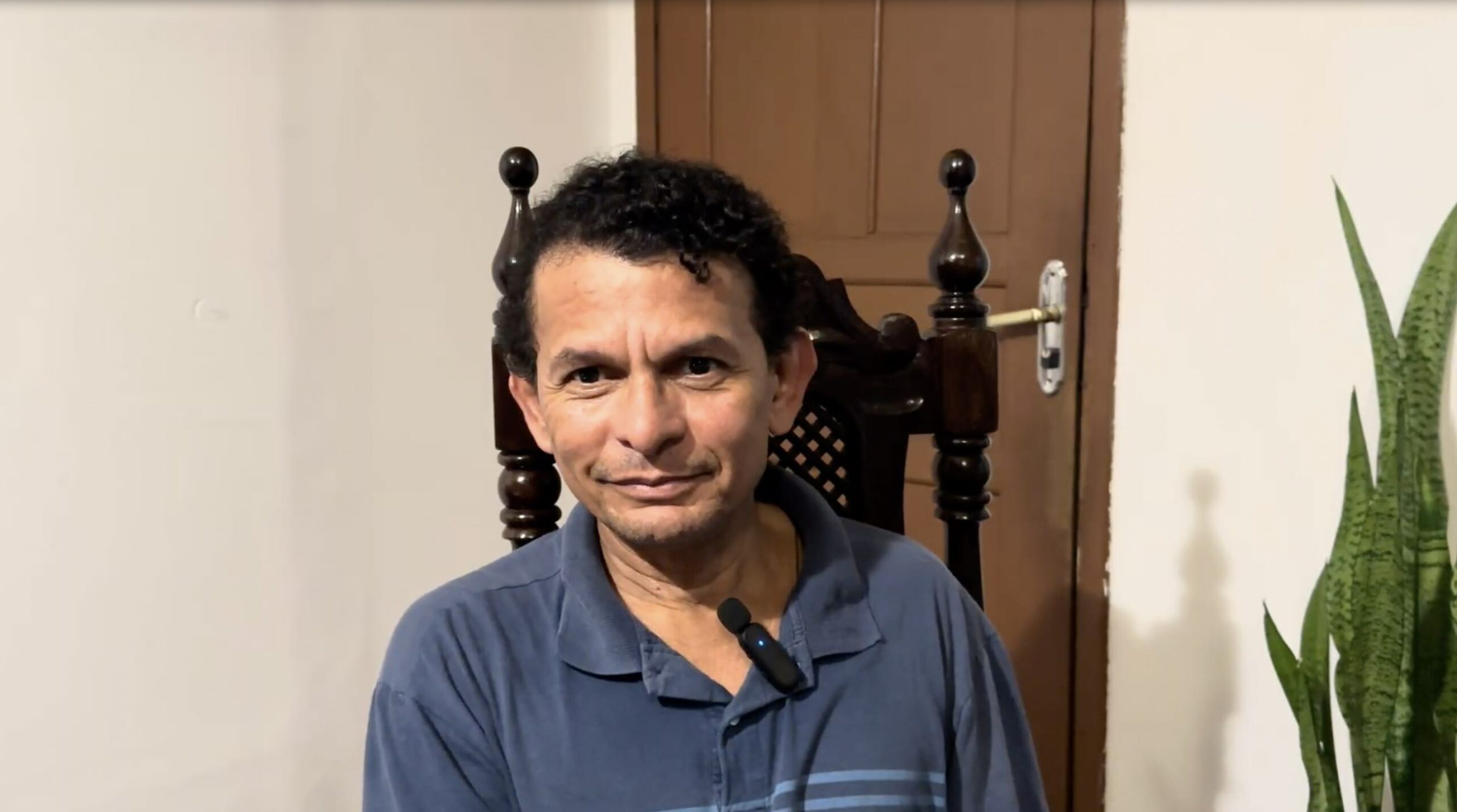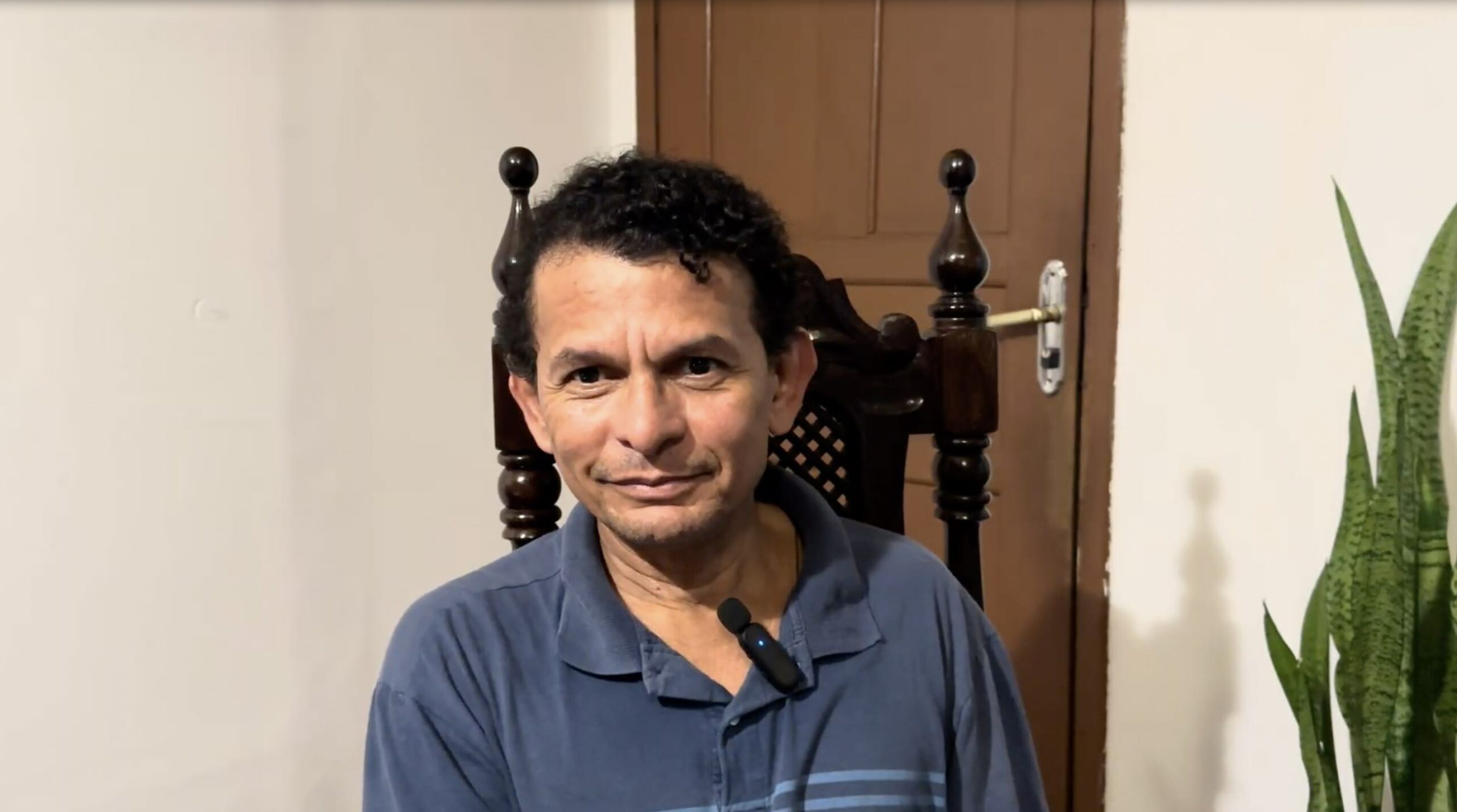
Flavio est consultant en microbiologie et en indicateurs de qualité environnementale. Né à São Luís do Maranhão, il est revenu dans son État natal en 2003. Dans son interview, il nous livre un témoignage précis et direct sur l’état critique des eaux de l’île de São Luís, entre pollution, manque d’assainissement et désintérêt de la population et des autorités publiques.
Une carrière ancrée dans l’étude de la vie
« Je travaille dans le domaine de l’environnement depuis 2005, peu après mon retour dans l’État du Maranhão. Je suis spécialisé en microbiologie et ses indicateurs liés aux environnements terrestres et aquatiques. »
Depuis 2003, à son retour au Maranhão, il s’est consacré à l’étude des micro-organismes — bactéries, champignons, virus — comme outils de diagnostic environnemental. En 2005, il a commencé à travailler dans le domaine de la surveillance de la qualité des milieux aquatiques et des sols de l’État.
« Le Maranhão est presque une île, une grande île continentale… Il compte 12 bassins hydrographiques, tout comme l’île de São Luís. Le territoire est riche en eau, mais la qualité de cette ressource est très préoccupante. »
Une ressource en eau abondante, mais dégradée
Flávio souligne le décalage entre l’abondance des ressources en eau et leur état sanitaire :
« Nous avons beaucoup d’eau, mais la qualité de notre eau est très douteuse. Les autorités publiques disposent d’informations, mais la population en général n’a aucune idée de ce que sont ces indicateurs de qualité de l’eau. »
Selon lui, la croissance urbaine incontrôlée et le manque d’assainissement sont les principales causes de cette dégradation.
Un système d’assainissement dramatiquement déficient
Flávio fait état d’un constat alarmant :
« À São Luís, le traitement des eaux usées ne dépasse pas 30 %. Cela signifie que 70 % des eaux usées contaminent d’une manière ou d’une autre les nappes phréatiques ou les sources d’eau de surface, qui se jettent dans la mer. »
Il explique que l’île de São Luís est probablement entourée de « coliformes fécaux », un indicateur biologique qui indique le niveau de pollution. Et il poursuit :
« Selon les normes établies par la législation brésilienne, l’eau potable doit contenir 0 % de coliformes fécaux. L’eau utilisée à des fins récréatives ou pour la baignade (rivières, lacs, plages, etc.), quant à elle, peut contenir jusqu’à 1 000 coliformes fécaux pour 100 ml d’eau, ce qui est énorme… ».
La banalisation de la pollution dans l’usage quotidien
Les pratiques domestiques quotidiennes contribuent à la dégradation de l’environnement dans un contexte de manque structurel d’infrastructures sanitaires, tant à São Luís (MA) que dans de nombreuses régions du Brésil.
Dans la municipalité de Raposa, qui fait partie de la Grande Île de São Luís, par exemple, le taux d’accès à l’assainissement de base est extrêmement faible, estimé à 0,1 %. La plupart des habitations ne disposent que de fosses rudimentaires, ce qui provoque l’infiltration directe des effluents dans le sol et la contamination potentielle de la nappe phréatique. Il n’existe aucune infrastructure de collecte ou de traitement des eaux usées, ce qui aggrave les risques sanitaires et environnementaux à long terme.
Un système d’assainissement de base complet doit comprendre les éléments suivants : gestion intégrée des déchets solides, collecte, transport et traitement des eaux usées, ainsi que collecte, traitement et distribution sûre de l’eau potable.
« Ici, il est courant de voir des déchets jetés dans la rue et de voir la « langue noire » couler dans les fossés des rues de la plupart des quartiers de la grande île et dans plusieurs villes de l’État du Maranhão. »
Cette « langue noire » fait référence aux eaux usées domestiques qui se déversent dans les igarapés (petits cours d’eau) avant de se jeter dans la mer.
Parallèlement, on observe une utilisation non rationnelle de l’eau potable, ce qui entraîne un gaspillage important des ressources en eau. L’eau destinée à la consommation humaine est souvent utilisée à des fins non essentielles, telles que le nettoyage domestique (sanitaires, chasses d’eau, nettoyage des trottoirs, avec des utilisations prolongées), le lavage des véhicules ou encore l’arrosage et le nettoyage des voies publiques, ce qui compromet la durabilité de l’approvisionnement en eau, en particulier dans des contextes de stress hydrique croissant.
Deux défis importants se distinguent :
– La nécessité de mobiliser les décideurs publics afin qu’ils donnent la priorité et investissent dans le développement d’infrastructures sanitaires de base ;
– L’importance de mener des actions de sensibilisation auprès des populations locales sur les relations directes entre les conditions sanitaires, l’assainissement, la santé publique et la qualité de vie.
Ces deux dimensions — institutionnelle et communautaire — sont indissociables pour garantir l’efficacité et la durabilité des politiques d’assainissement.
L’échec de l’éducation environnementale au Brésil
Flávio insiste sur le manque de sensibilisation à tous les niveaux, y compris dans le monde scolaire :
« Les enseignants veulent mettre en place le tri sélectif, mais comment le faire si la municipalité n’a pas les structures nécessaires pour cela ? »
Même à São Luís, les efforts restent minimes :
« Le tri sélectif concerne environ 3 à 5 % de la population, ce qui correspond à la moyenne nationale. Mais actuellement, il n’existe pas de données précises sur le pourcentage de tri sélectif dans l’État du Maranhão. »
La situation est critique : sur les 217 municipalités du Maranhão, une seule dispose d’une décharge sanitaire. Les autres ont des décharges à ciel ouvert.
Un cycle de pollution systémique
Pour Flávio, tout est lié : croissance urbaine désordonnée et sans planification, absence de politiques publiques, comportements banalisés, éducation insuffisante, pollution généralisée. Il conclut par un exemple concret :
« J’ai vu une interview d’une personne qui se baignait dans une rivière appelée Pimenta, qui affirmait n’avoir jamais été malade. C’était une personne native, qui avait grandi en se baignant dans cette rivière. En microbiologie, on dit que ce qui ne tue pas immunise. Mais si nous amenons quelqu’un d’Europe et que nous le mettons dans n’importe laquelle des rivières ici dans la capitale, par exemple la rivière Pimenta et/ou Anil, ce sera fatal. »
La dissociation entre les connaissances scientifiques et la vie quotidienne
Lorsque Flávio intervient (conférences, cours, etc.) dans des écoles ou devant des agents publics, comme les pompiers, il partage des données scientifiques sur la qualité de l’eau, notamment la présence de coliformes fécaux dans les eaux de baignade. Cependant, ces connaissances ont peu d’impact durable :
« J’explique : dans le cas de la baignabilité des masses d’eau, par exemple sur les plages, pour chaque 100 ml d’eau que l’on boit à la plage, 1 000 coliformes fécaux sont légalement acceptables. Ils m’ont répondu : « Bon sang, à quelle heure vais-je mourir ? »
Malgré le choc initial, une sorte d’amnésie associée à une banalisation sociale s’installe. L’information est rapidement oubliée, car elle entre en conflit avec la réalité quotidienne : les gens vivent en contact avec les déchets et les égouts sans conséquences immédiatement visibles.
Ce décalage entre les connaissances scientifiques et la vie quotidienne de la population en général empêche l’émergence d’une conscience collective.
L’invisibilité des maladies et l’échec de la sensibilisation
Flávio souligne que les pathologies liées à l’eau polluée, telles que les diarrhées ou les maladies gastro-intestinales, ne sont pas perçues comme étant liées à la pollution en raison de l’assainissement précaire.
« Ils ne se rendent pas compte que lorsqu’ils atteignent 50 ans, ils ont d’énormes problèmes gastriques. Ils ne font pas le lien. »
Il rappelle que les indicateurs de maladies d’origine hydrique augmentent considérablement à chaque saison des pluies, mais que ces données sont peu ou pas connues, voire parfois pas divulguées.
« Même si je répète que la plage n’est pas propice à la baignade, les gens n’ont pas accès à cette information et/ou n’en comprennent pas l’importance. »
La dynamique de la mer : un recyclage permanent des déchets
Malgré les initiatives citoyennes telles que le groupe Salve as Praias, qui collecte jusqu’à deux tonnes de déchets toutes les deux semaines, la mer apporte de nouveaux déchets à chaque marée.
« Notre marée est très forte, elle atteint 6 à 7 mètres. Si je ramasse aujourd’hui une tonne de déchets, la prochaine marée en déposera trois ou quatre tonnes. »
Cette lutte contre la pollution devient le « mythe de Sisyphe » des militants écologistes : un effort constant, mais voué à être annulé par l’absence d’actions structurelles.
Les conséquences écologiques et climatiques de l’inaction
Au-delà des défis sanitaires, Flávio rappelle que la pollution organique contribue à la crise climatique :
« Plus nous déversons d’eaux usées dans la mer, plus de matière organique est introduite dans le système. À un certain moment, cette matière organique se dépose au fond de l’eau et produit du méthane, qui est l’un des gaz à effet de serre, avec un potentiel plus important que le dioxyde de carbone ».
La densité de l’eau change également, ce qui modifie l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Les espèces animales et végétales les plus fragiles disparaissent. Flávio ajoute :
« L’être humain reste l’un des êtres vivants les mieux adaptés au changement climatique, mais de nombreuses autres espèces ne survivront pas. »
Il met en garde contre la rupture des cycles biogéochimiques fondamentaux : carbone, azote, phosphore. Chaque action humaine – déforestation, incendies, déversement de produits chimiques, eaux usées et/ou déchets – contribue à cette déstabilisation.
Le fragile espoir apporté par la jeunesse et la connaissance
Face à cette situation, Flávio refuse de succomber au pessimisme, même s’il admet être « désespéré par l’humanité ». Il continue à enseigner, à sensibiliser, en misant sur les jeunes :
« Ce sont les jeunes qui subiront les pires conséquences. C’est eux que nous devons éduquer et agir. »
Il prône une mobilisation collective pour exiger l’application des lois existantes.
« Ce qui manque au Brésil, ce ne sont pas les lois. Ce qui manque, ce sont les mouvements citoyens pour exiger leur application. »
Accès limité aux analyses environnementales : l’obstacle des coûts
Malgré les compétences scientifiques et les technologies disponibles, les analyses de l’eau ou du sol sont coûteuses :
« Un échantillon d’eau de 100 ml coûte environ 200 reais, selon le nombre d’indicateurs à évaluer. Et souvent, il faut en faire une centaine par an. »
Il insiste : ce n’est pas une question de manque de technologies, mais d’absence de partenaires financiers pour soutenir ces campagnes.
Des exemples montrent que ces analyses peuvent être déterminantes pour les communautés locales en conflit avec l’agro-industrie et/ou l’agroalimentaire. Mais sans financement, aucune preuve ne peut être présentée juridiquement.
« Ce qui limite aujourd’hui la capacité à défendre les communautés, ce sont les ressources financières. »
Des contaminants invisibles, mais persistants
Flávio insiste sur la nature instable et fugace des polluants chimiques environnementaux. Leur détection nécessite une rigueur scientifique. « Si je prélève, par exemple, un mois plus tard ou 15 jours plus tard, je risque de ne rien trouver. » Il explique que les études de pollution exigent des prélèvements fréquents à intervalles très courts : « Je dois réduire le temps de prélèvement et augmenter le nombre d’échantillons. »
Dans le cas de l’eau, « un échantillon correspond à 100 ml d’eau », tandis que pour le sol, « nous prélevons un échantillon de 500 g de terre ». Chaque analyse a un coût, qui se multiplie rapidement lorsqu’il s’agit d’établir des preuves solides dans le temps.
Une invitation résultant d’un constat communautaire
Flávio se souvient du contexte de sa visite chez les indigènes Araribóias. L’invitation venait d’un ancien collègue, à l’époque où Flávio travaillait au Laboratoire d’analyses environnementales du Secrétariat d’État.
La communauté avait observé des signes de dégradation de la biodiversité locale : « Certaines espèces importantes sont en train de mourir, de se dessécher ».
Face aux risques sanitaires, les habitants ont cessé de boire l’eau de la rivière, préférant les puits artésiens. Flávio souligne que le principal problème réside dans le voisinage immédiat : « La zone des indigènes est entourée de pâturages, de plantations intensives de soja et d’eucalyptus traités avec des pesticides ». Les intrants agrochimiques finissent par contaminer l’eau et le sol, dans une indifférence totale.
Interrogé sur les risques encourus par ceux qui dénoncent ces pratiques, il répond sans détour : « Nous sommes en danger permanent. Comme l’agro-industrie ne se soucie que de ses profits, elle ne se préoccupe pas de l’aspect écologique des systèmes. »
La pollution invisible et la misère silencieuse
Outre les pesticides, Flávio attire l’attention sur un autre facteur souvent négligé : les déchets solides (ordures) et les eaux usées. Dans de nombreuses communautés vulnérables, y compris celle des Araribóias, il observe un schéma similaire : « Les déchets et les eaux usées […] Et ils ne savent pas quoi faire. »
Le lien entre pollution et santé publique est rarement perçu : « Ils ne voient pas vraiment le rapport avec le plastique dans la rivière… » Ce manque de connaissances aggrave leur exposition.
Un espoir conditionné au financement
« Imaginez, par exemple, que je gagne aujourd’hui 52 millions de reais. Je créerais un laboratoire et apporterais tout le soutien nécessaire aux communautés traditionnelles, quilombolas et autochtones. » Ce rêve souligne l’ampleur du vide structurel. Peu ou presque aucune des universités locales ne dispose de ses propres moyens, d’équipements et/ou de ressources financières pour réaliser ce type d’analyses. Les rares laboratoires dépendent du financement provenant des pollueurs eux-mêmes.
Flávio conclut par un appel implicite : toutes les communautés vulnérables devraient avoir accès à des moyens d’analyse indépendants.
« Ce qu’il faudrait, c’est que toutes les communautés de pêcheurs […] aient le droit d’avoir quelqu’un qui puisse faire les analyses, de gérer elles-mêmes les analyses. »
Les limites structurelles du système de surveillance environnementale
Flávio souligne l’insuffisance des protocoles institutionnels de surveillance.
« Vous pensez que prélever de l’eau pendant une semaine va résoudre le problème ? Ce n’est pas le cas. » Il recommande plutôt un modèle de surveillance systématique, avec des prélèvements effectués toutes les 24 à 48 heures maximum.
Il regrette que les organismes publics ne mènent pas le processus jusqu’au bout : « Ils font juste le minimum nécessaire. […] C’est au niveau de l’échantillonnage que notre législation est insuffisante. »
Une stratégie d’espoir fondée sur les connaissances locales
En conclusion, Flávio propose une vision d’avenir fondée sur la complémentarité entre les connaissances des communautés locales traditionnelles et/ou autochtones et l’expertise scientifique :
« Je pense à une stratégie qui serait la suivante : rassembler les connaissances des communautés traditionnelles, qui ont des connaissances locales […] et rechercher des ressources pour générer des données scientifiquement rigoureuses. »
Il appelle à une véritable collaboration : « Il faut impliquer les populations traditionnelles et/ou autochtones dans ce processus. […] Il ne s’agit pas seulement de donner de l’argent. »
L’objectif n’est pas seulement de prouver scientifiquement la pollution, mais de transformer les pratiques par le dialogue et le transfert de connaissances.
Témoignages du même tableau